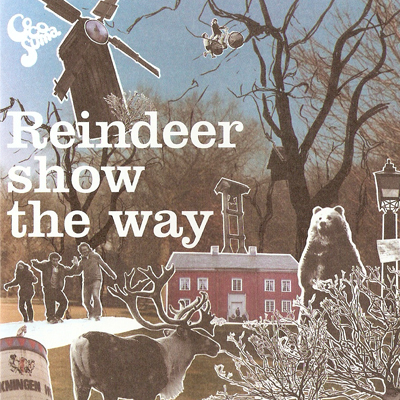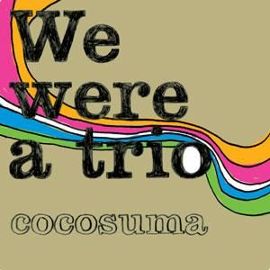L’histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton Haven : cinq adolescents au comble de l’âge ingrat fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec l’absorption d’un nombre impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur liste : The World’s End (La Fin du Monde). Une vingtaine d’années plus tard, nos cinq mousquetaires ont tous quitté leur ville natale et sont devenus des hommes avec femme, enfants et responsabilités, à l’alarmante exception de celui qui fut un temps leur meneur, Gary King, un quarantenaire tirant exagérément sur la corde de son adolescence attardée. L’incorrigible Gary, tristement conscient du décalage qui le sépare aujourd’hui de son meilleur ami d’antan Andy, souhaite coûte que coûte réitérer l’épreuve de leur marathon alcoolisé. Il convainc Andy, Steven, Oliver et Peter de se réunir un vendredi après-midi. Gary est comme un poisson dans l’eau. Le défi : une nuit, cinq potes, douze pubs, avec un minimum d’une pinte chacun par pub. À leur arrivée à Newton Haven, le club des cinq retrouve Sam, la soeur d’Oliver pour qui Gary et Steven en pincent toujours. Alors que la fine équipe tente, tant bien que mal, d’accorder le passé avec le présent, une série de retrouvailles avec de vieilles connaissances et des lieux familiers les font soudain prendre conscience que le véritable enjeu, c’est l’avenir, non seulement le leur, mais celui de l’humanité entière, et arriver à «La Fin du Monde» devient le dernier de leurs soucis… (Allocine.fr)

Trop long ce pitch mais j’avais la flemme de le faire moi-même.
Je savais évidemment après avoir vu Spaced leur série, ainsi que Shaun of the Dead et Hot Fuzz leurs 2 premiers films, qu’on partageait la même (contre) culture et qu’on devait être de la même génération mais j’ai vérifié juste après la séance : Edgar Wright est né en 1974, Simon Pegg en 1970, Nick Frost en 1972.
Je suis né en 1973.
Alors forcément, la première partie du film… Comment dire? Me parle beaucoup. Loaded de Primal Scream, les Soupdragons, les Stone Roses, Suede, There’s no other way de Blur, The only one I know des Charlatans, Do You Remeber the First Time? de Pulp: comme Wright, Pegg et Frost, comme leurs 5 héros lorsque débute l’action, j’avais entre 17 et 20 ans lorsque ces chansons ont été créées. Les entendre enchaînées comme ça, dans ce qui démarre qui plus est comme une comédie sur la crise de la quarantaine, c’était à la fois troublant, réconfortant, émouvant et déprimant. Lorsqu’a retenti What you do to me de Teenage Fan Club, j’ai cru que j’allais pleurer.
Tout ça pour dire qu’il m’est très difficile d’être objectif tant la première partie déroule absolument tous les ingrédients susceptibles de susciter mon enthousiasme et emporter mon adhésion : je suis la cible parfaite des effets et affects avec laquelle elle joue.
Donc, ça marche: je trouve ça drôle, très drôle, nostalgique mais également très lucide. Avec entoile de fond l’Angleterre que le trio sait décidément très bien évoquer: grise, verte et pop, à la fois déprimante et excitante, telle qu’on la découvre lorsqu’on s’y rend la première fois à l’adolescence et telle qu’on la chérit depuis. Même mondialisée, uniformisée, « Starbucked » comme le disent très justement les héros, il subsiste toujours en elle quelque chose du Village Green des Kinks : là aussi, c’est très réconfortant (cette dernière chanson était d’ailleurs utilisée dans Hot Fuzz, dans le versant « chronique d’une bourgade paisible de l’Angleterre éternelle » du film).
J’ai l’impression d’avoir un peu plombé l’ambiance: c’est surtout très drôle évidemment.
Bon, le film est lancé, comme les 5 les gars toujours en course pour le « Golden Mile », leur Grand Chelem des 12 pubs de Newton Haven (« golden mile » a été traduit par « barathon », c’est bien vu je trouve… D’ailleurs tous les sous-titres étaient vraiment bons): ils enchaînent les pubs et les pintes, partagent pour les uns leurs frustrations, leur agacement et leur rancœur, pour l’autre (Gary King aka Simon Pegg) son enthousiasme aveugle et sa nostalgie maladive.
Arrive donc la scène pivot du film (la rencontre avec l’ado dans les toilettes du pub) qui marque également sa limite selon moi.
Jusque là, une comédie sur la crise de la quarantaine donc. Après cette scène, une pochade de geek. Plaisante certes, toujours drôle, mais plus émouvante du tout. Wright échoue à mélanger les 2 genres (comédie générationnelle mélancolique et SF potache), contrairement au très sous-estimé Voisins du 3ème type par exemple.
Peut-être parce que Wright est anglais, donc européen et que subsiste toujours en lui un fond d’ironie, un second degré qui l’empêchent de laisser libre cours à des sentiments un peu couillons mais nobles, des sentiments qui ne font pas peur à ses alter-ego américains. C’est dommage. D’ailleurs, Paul, film mettant en scène Pegg et Frost également, réussissait lui aussi ce mélange des genres, parvenait à émouvoir sincèrement derrière les blagues de geek: comme par hasard, le film était réalisé par un américain (Greg Mottola).
Ce qui explique selon moi, qu’il foire par exemple complètement la scène de « retrouvailles » entre Gary et Andy (celle où Gary tombe enfin le masque) et qu’il se mélange également un peu les pinceaux dans la scène de résolution (dans le sous-sol du pub). Alors que les vannes de cette même scène fonctionnent parfaitement: ce sont vraiment des paroles de mecs bourrés, c’est très drôle et très réaliste. Mais le versant « sérieux » de la scène est vraiment maladroit: on sent bien que les mecs n’arrivent pas à s’en dépatouiller, qu’ils se sentent un peu cons et désemparés, qu’ils ne savent pas comment justifier la valeur de l’espèce humaine, puisque c’est ce dont il s’agit. Ils essaient mais ils n’y parviennent pas. Limite embarrassant… Ils sont sauvés par un jem’enfoutisme des plus sympathiques mais c’est dommage.
Idem pour la toute fin: un gag génial (le Cornetto) mais le reste est traité par dessus la jambe. Qu’est devenu Gary au bout du compte? Que fait-il exactement avec cette « escouade »? C’est quoi cet accoutrement de chasseur de primes? On n’en saura rien… Autant dire que LA question posée par le film (comment rester fidèle à ses jeunes années sans pour autant vivre dans le passé? comment vieillir tout en restant cool tout en n’etant pas pathétique? comment grandir?) restera sans réponse. Et ça m’emmerde parce que c’est LA question de ma génération, celle que les comédies américaines traitent de si belle et de si juste manière depuis une dizaine d’années.
Au bout du compte, le Dernier pub avant la fin du monde me fait donc le même effet que les autres films du trio Wright/Pegg/Frost, alors qu’il avait tout pour devenir leur premier film « adulte »: trop geek (même pour moi…), trop mal foutu mais foncièrement agréable et réjouissant, drôle et porté par un enthousiasme communicatif. Vraiment dommage que tout ne soit pas au niveau de son premier tiers mais j’ai envie de n’en garder que le positif: en l’état, c’est déjà très bien.